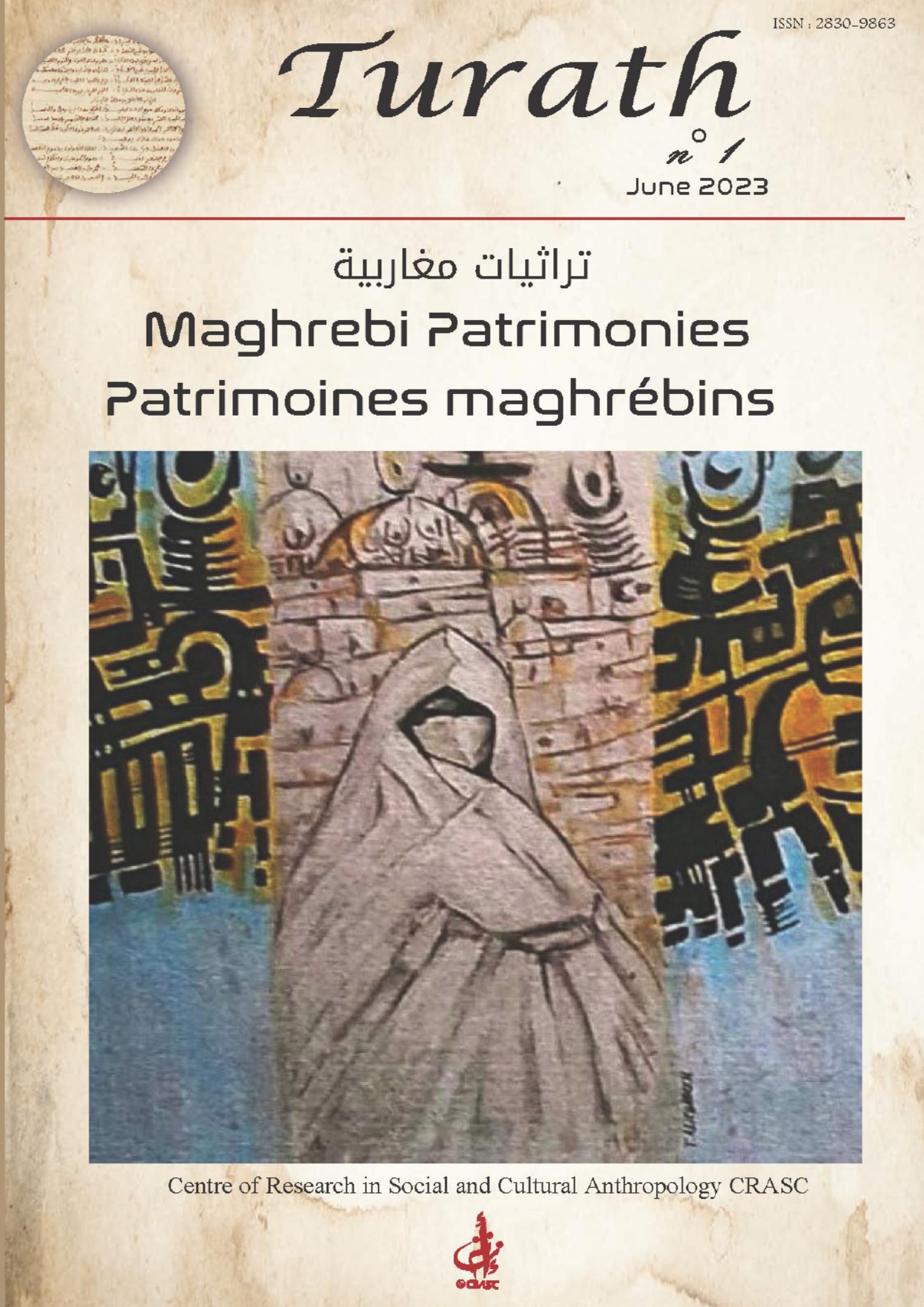Eléments d’histoire sociale de la chanson populaire en Algérie. Textes et contextes
Contenu principal de l'article
Résumé
L’une des particularités des musiques et des chants en Algérie est celle d’avoir suscité très peu d’intérêt quant à leurs origines, leur usage et leurs caractéristiques formelles pour les chroniqueurs et lettrés autochtones avant la colonisation française.
Dans cette étude, nous étalerons la variété des styles et des modes de la chanson populaire en Algérie en considérant quelques exemples puisés au travers des chants populaires et des rituels sociaux fondés sur des circonstances ou des genres (chansons satiriques et parodiques, par exemple) On accordera au café chantant un intérêt à la fois historique mais aussi documentaire quant à l’émergence des premières grandes interprètes féminines de la fin du 19ème siècle en Algérie. Il y a bien évidemment toute la tradition contestataire et critique populaire qui tissera ses couplets et ses refrains au travers de toutes les contrées du pays profond durant toute la durée de la présence coloniale.
Cet ensemble de rappels qui ont porté à la fois sur un parcours dans la durée et sur quelques expressions de la chanson populaire en Algérie ne sauraient donner toute l’amplitude des formes et des circonstances de cette expression aussi variable qu’éphémère dans la plupart de ses formulations.
Details de l'article

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Références
Bachetarzi, M. (1977, janvier 1-7). Le vieil Alger musical. Jeunesse Action (6).
Bachir, H. A. (1964, Juin-Juillet). Qu'est-ce qu'une musique nationale? Nouvelle critique, (156-157), 128.
Bel, A., & Ricard, P. (1913). Le travail de la laine à Tlemcen. Alger : Typographie Adolphe Jourdan.
Bencheneb, S. (1933, 1er et 2ème trimestre). Chansons satiriques d'Alger (1ère moitié du 14ème siècle de l'hégire). Revue Africaine , 84.
Berque, J. (1980). Langages arabes du présent. Paris : Gallimard.
Boughrara, H. (2002). Voyage sentimental en musique arabo-andalouse, Paris, méditérannée.
Cazebonne, G. (1950). L'Aurès. Economie familiale. Tourisme . Administrateur adjoint à la commune mixte de l'Aurès.
Cluny, C. (1945). Sabir qui chante, Recueil de 12 chansons en sabir. Paris : Marcel Labbé.
Desparmet, J. (1907). La poésie arabe actuelle à Blida et sa métrique. [Actes du XJVème Congrès Internationnal des Orientalistes], 1904, t. III, 1ère partie,
437-602, p. 166.
Desparmet. (1939). Les chansons de geste de 1830 à 1914 dans la Mitidja. Revue Africaine, (83).
Didelon, M. (1951). L'évolution de la poésie à Sidi Bel Abbès et sa région. CHEAM.
Gourgeot, F. (1891). les sept plaies de l'Algérie. Alger, édité par Imprimerie Pierre Fontana et Cie.
Gruzinski, S. (1999). la pensée métisse. Paris : Fayard.
Hachelef, A. E. (1993). Anthologie de la musique arabe (1906-1960). Paris : Centre Culturel Algérien/Publisud.
Haddad, M. (2007). Tradition orale, mémoire collective et quelques repères historiques dans l'Algérie coloniale: le cas des Aurès et du pays chaoui. Dans E. LSH (Éd.). Lyon.
Haddad, M. (s.d.). Récupéré sur http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/ France_ algérie/communication.php3 ?id-article : 227.
Mahfoufi, M. (2006). Chants de femmes en Kabylie, Fêtes et rites au village. Alger : CNRPAH.
Marçais, G. (1950). Tlemcen. H. LAURENS-Paris.
Meynier, G. (1981). L'Algérie révélée. Genève-Paris : Librairie Droz.
Miliani, H. (2005). Sociétaires de l'émotion. Etudes sur les chants et musiques d'Algérie. Oran : Dar El Gharb.
Morizot, J. (1991). L'Aurès ou le mythe de la montagne rebelle. Coll. Histoire
et Perspectives Méditerranéenne. Paris : L'Harmattan.
Raymond, A. (1987). Les caractéristiques d'une ville arabe « moyenne » au XVIIIème siècle. Le cas de Constantine. Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, n° 44, pp. 134-147.
Rhais, E. (1920). Le café chantant. Paris : Librairie Plon.
Rouanet, J. (1922). La musique arabe dans le Maghreb. Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire , p. 2822.
Saidani, M. (2005). La musoque du constantinois. contexte, nature, transmission et définition. Alger : Ministère de la Culture.
Smati, M. (1998). Les élites algériennes sous la colonisation, tome 1. Dahlab.
Soualah, M. (1913). Cours supérieur d'arabe parlé d'après la Méthode directe. Alger : Jourdan.