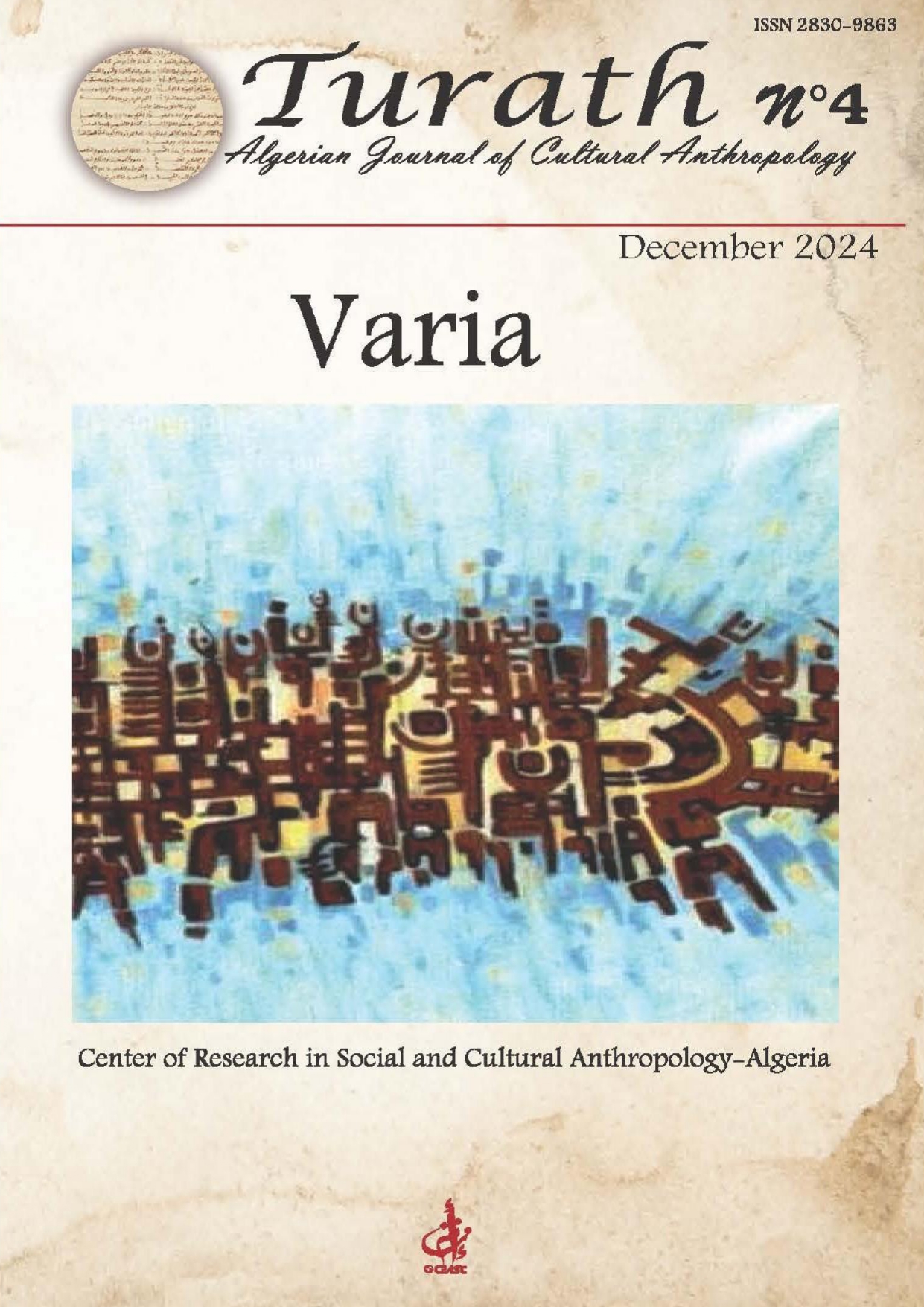L’ambiguïté dans les marges du texte
Contenu principal de l'article
Résumé
Nous nous sommes interrogé sur les fonctions d’un espace ouvert les "instances préfacielles" (paratexte = péritexte + épitexte) (Genette, 1987, p.11) qui échappe à l’autorité de la méthode (recherche et enseignement), au champ explicite d’expression de l’auteur (texte) ainsiqu’au producteur éditeur de l’ouvrage. Les interférences dans cet espace de non-droit pour l’enseignant dans la transmission d’un savoir, la littérature, nous fournira un échantillon d’illustrations. Suite à une politique de "démocratisation" de l’enseignement en Algérie, le potentiel de lecteurs a été massivement démultiplié, créant des besoins nouveaux, induisant des habitudes de lecture nouvelles, souvent mimétiques.
En important le livre massivement, et ce constat est valable aussi bien pour le français que pour l’arabe, on a aussi importé des schémas culturels de consommations inadaptés à une société à forte tradition orale, n’ayant pas sa propre tradition typographique. Cette rupture exige aujourd’hui, une relecture sereine et une capacité de discernement de ces effets, en particulier dans le champ pédagogique, car il s’agit de concevoir une ergonomie de cet outil (le livre) pour assurer un transfert des savoirs dont nous avons besoin.
Le péritexte reste un lieu ouvert que se disputent deux institutions de communication, l’une transactionnelle (valeur marchande) et l’autre interpersonnelle (plus-value intellectuelle /originale). Dans la production d’ouvrages, ces deux échelles de valeur sont en compétition permanente et induisent des rapports de force, qui souvent se font au détriment l’une de l’autre. C’est dans un tel contexte que la forme que prend le péritexte devient un enjeu idéologique où s’exerce une violence symbolique. (Bourdieu, 1996, p.16).
Details de l'article

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Références
Argod-Dutard, F. (1998). La linguistique littéraire. Armand Colin.
Bartes, R. (1964). Essais critiques. Éditions du Seuil.
Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision suivi de L’emprise du journalisme. Raison d’agir, Liber.
Choukri, M. (1997). Le pain nu. Éditions du Seuil. (Traduit de l’arabe et préfacé par T. Benjelloun).
Genette, G. (1987). Seuils. Éditions du Seuil.
Genette, G. (1992). Esthétique et poétique. Éditions du Seuil.
Kateb, Y. (1956). Nedjma. Éditions du Seuil.
Kundera, M. (1985). Le livre du rire et de l’oubli. Gallimard.
Palou, J. (1966). Nouvelles histoires étranges. Casterman.
Robert, M. (1984). La tyrannie de l’imprimé. Grasset.